I. Résumé
Social et productif

L'allocation universelle (AU) de notre modèle "synthétique" consiste en une double rationalisation :
du système de sécurité sociale, par (i) sa simplification et (ii) l'éradication de la pauvreté financière ;
du système productif, en dirigeant le capital vers le travail, plutôt que l'inverse.
Ce sont là les deux faces – sociale et productive – d'une même pièce. Cette dualité détermine la dynamique vertueuse de l'AU. Comprenons bien, en particulier, l'importance du changement de paradigme que constitue l'inversion de la dynamique Travail ⇒ Capital en Capital ⇒ Travail. Dans le paradigme capitaliste, le travail c-à-d les humains doivent se délocaliser vers le capital : ainsi l'exode rurale se traduit – via la logique Maximisation des profits ⇒ Concentration du capital – par l'uniformisation des paysages, qui engendre un appauvrissement de la faune et de la flore. Avec l'AU du modèle synthétique, c'est au contraire le capital qui est distribué là où vivent les individus, stimulant ainsi la production locale et, partant, le développement durable (DD).
N.B. Il existe certes déjà une dynamique de déplacement du capital vers le travail. C'est typiquement le cas des délocalisations d'entreprises des pays les plus développés, vers des pays moins développés où les salaires sont substantiellement inférieurs. Mais il s'agit de transferts entre personnes morales, ce qui équivaut in fine à des transferts de capitaux non financiers, tandis que l'AU transfert du capital financier, et cela vers des personnes physiques ...
Boucle de rétroaction
Éradication de la pauvreté financière. Le montant de l'allocation universelle (AU) de notre modèle "synthétique" est de 1250 euros/mois par adulte ⇒ 1250 / 3 ≈ 400 par enfant (France, 2023, sur base des statistiques disponibles de 2021), soit légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, estimé à 1.100 euros/mois en 2019.
Équilibre budgétaire. Cette AU n'est pas taxée. D'autre part, les systèmes social, fiscal et monétaire sont considérablement réformés, sur base de deux principes : simplification et redistribution. Il en résulte que le besoin de financement de l'AU du modèle synthétique est nul ! Et cela sans tenir compte des économies que l'État réalisera en supprimant la partie superflue de l'appareil administratif requis pour géré l'actuel complexité du système socio-fiscalo-monétaire.
Libération du travail. Outre le montant relativement élevé de son AU, la seconde particularité du modèle synthétique est qu'il dissout l'antagonisme apparent entre sécurité sociale et rationalisation financière : ainsi les notions de chômage et de pension deviennent obsolètes. Cette libération du parcours professionnel des individus est le mécanisme qui rend l'AU durable, en termes de solde public et de développement économique. Alors que le chômage et les pensions sont des dépenses réactives, notre AU qui les remplace est un investissement proactif qui offre à chacun une base financière lui permettant de développer, à son rythme, une activité productive qui le motive.
Alors que la théorie économique classique focalise sur la causalité Développement ⇒ Séc. soc., notre modèle synthétique complète cette dynamique par une boucle de rétroaction, en ajoutant la relation Séc. soc. ⇒ Dév.dur..
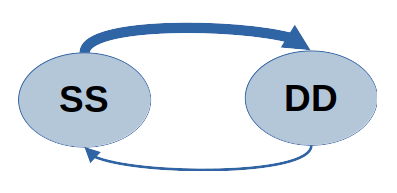
Boucle de rétroaction entre sécurité sociale et développement durable.
Cette dynamique de boucle de rétroaction entre sécurité sociale et développement durable repose sur les notions de symétrisation monétaire et de champ de valeurs économiques.
Offre de travail libre
Travail
libre
L'avènement de l'allocation universelle du modèle synthétique, dont le niveau se situe légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, fera de chaque citoyen un rentier, pouvant ainsi vivre (chichement...) sans devoir travailler. Mais il pourra également travailler contre rémunération pour augmenter son niveau de vie, ou travailler à titre bénévole dans des organisations qui lui plaisent (type d'activité, ambiance interne, etc).
Au total, le modèle synthétique réduit considérablement la pauvreté, tout en donnant à chacun la possibilité de créer sa propre entreprise ou d'effectuer une activité bénévole qui lui plaît. Cette évolution va transformer notre conception du travail, lequel ne sera plus forcé mais choisi. Ainsi, ne devant plus travailler pour vivre, l'individu peut alors vivre pour travailler librement. Une des sources les plus fondamentales du bonheur réside dans la production libre de biens ou services utiles à autrui, et dont notre maîtrise (le savoir-faire) se développe sans cesse (NB : on apprend mieux ce que l'on apprécie). Il en résultera une profonde transformation – qualitative et quantitative – du mix de biens & services que nous produisons et consommons.
Faisabilité
de l'AU
Nous avons montré que l'AU ne devrait pas avoir d'effet négatif significatif sur l'offre de travail, tant que son niveau demeure inférieur à 3.000 euros/mois (France, 2023, cf. /faisabilite#offre-travail). Par conséquent, une AU de 1250 euros/mois devrait au contraire stimuler l'offre de travail et la création d'entreprises familiales, dès lors que – contrairement au système actuel d'allocations d'aide au revenu – l'AU est cumulable avec une activité professionnelle déclarée. C'est pourquoi 1.250 euros/mois est le niveau minimum de l'AU. Si la volonté politique existe, on pourrait résolument l'augmenter jusqu'à la moitié du PIB/hab, soit 3200 / 2 = 1600 euros/mois (France, 2023).
L'effet quantitatif de l'AU sur l'offre de travail est l'arbre qui cache la forêt de l'impact qualitatif de l'AU sur la production de biens et services, notamment en favorisant la production locale (cf. /effets-positifs).
L'effet inflationniste induit par la réduction de l'offre de travail, et partant la production de biens et services, est également modéré. Quant à l'effet inflationniste d'origine monétaire, il est théoriquement nul puisque le financement monétaire de l'AU (AUD, soit 16 % de l'AU) ne s'ajoute pas à l'actuelle création monétaire, mais s'y substitue.
Si la pertinence sociale d'une AU d'un tel montant fait peu de doute (*), il restait à concevoir les conditions fiscales et monétaires de sa faisabilité économique. C'est là la contribution principale de mes travaux de théorie pratique de l'AU, que je mène depuis le début des années 2000.
(*) La pertinence du principe même d'AU est cependant contestée, notamment par certains syndicats (cf. /critiques).
Modèle synthétique
Notre modèle d'AU est qualifié de "synthétique" car, ne se réclamant d'aucun courant idéologique particulier, il intègre au contraire le meilleur des mesures proposées par les différents courants – libéral et communiste – en matière de rationalisation du système de sécurité sociale (cf. /modeles-politiques).
D'autre part ce modèle intègre financements monétaire et fiscal, dans le cadre d'une réforme des systèmes monétaire, fiscal et de sécurité sociale fondée sur quatre objectifs : simplification, (re)distribution, symétrisation (principe d'égalité) et objectivation (formules universelles) :
la réforme monétaire consiste en la symétrisation de l'offre monétaire. La création monétaire est désormais interdite aux banques, et réalisée par l'État. Celui-ci distribue la création monétaire, aux seules personnes physiques, gratuitement, sans condition, et en parts égales. Le taux de croissance monétaire est déterminé de façon objective par la formule du taux de croissance monétaire universel (c) de la théorie relative de la monnaie, fonction de l'espérance de vie (v) : c = 4 / v. Dans le cas de la France, il correspond presque exactement au taux de croissance moyen de la masse monétaire de l'euro depuis sa création (6%) !
la réforme fiscale consiste en une formulation simple et objective d'un taux d'imposition universel, fonction du revenu brut (YB), et dont le paramètre est le PIB par habitant : TU(Yb) = 1 - ( 1 + Yb / (PIB/hab) ) - 1. Cette formule rend obsolète la complexité des taux marginaux, tout en étendant la progressivité fiscale aux plus hauts revenus. En outre, ce taux T est global, on ne fait plus la distinction (très théorique) entre impôts sur les revenus et cotisations sociales. Enfin, le taux des prélèvements obligatoires passe de 44 % du PIB actuellement (France, 2023) à 52 % (PS : ce dernier taux ne prend pas en compte la baisse des dépenses administratives résultant de la simplification du système socio-monétaro-fiscal, de sorte qu'il devrait finalement s'approcher de 50 %, niveau correspondant au principe de symétrie, fondamental dans notre modèle de système économique universel).
la réforme sociale consiste dans le remplacement des dépenses actuelles de sécurité sociale (NB : sauf celles de santé) par l'AU. Ce faisant, on supprime :
- la notion de chômage (et partant, la problématique de "fraude sociale" qui y est liée) ;
- la notion de pension ;
- la discrimination salarié vs indépendant ;
- l'effet de trappe à inactivité ;
- le phénomène de non exercice des droits à l'aide sociale.
Le montant de l'AU (1250 euros/mois par adulte ⇒ 1250 / 3 ≈ 400 par enfant, en France en 2023) est déterminé par notre modèle synthétique, après réforme fiscale & monétaire, et de sorte que son besoin de financement soit nul voire négatif ⇒ sans augmentation de la dette publique (cf. /financement-synthese#modele-informatique).
Le financement de l'AU se répartit entre :
financement monétaire (donc distributif) : AUD = ΔM / N ≈ 4 / v * Mt-1 / Nt = 16 % de l'AU ;
financement fiscal (donc redistributif) : AUR = AU - AUD = 84 % de l'AU.
Tout sur le financement du modèle synthétique : /financement-synthese
Régulation automatique des marchés
Historiquement, on constate que le développement des marchés (définis comme étant "des lieux où consommateurs et producteurs se rencontrent physiquement") induit – via la logique Maximisation des profits ⇒ Concentration du capital – l'uniformisation et partant l'appauvrissement de l'environnement. Ce qui manque donc au phénomène auto-organisé que sont les marchés, c'est un mécanisme de régulation automatique, qui maintient leur taux de concentration en-dessous du niveau au-delà duquel le degré d'uniformisation induit devient nuisible à l'environnement.
Il existe déjà un large consensus parmi les économistes, pour reconnaître l'effet nuisible des écarts de richesse excessifs, pour la démocratie et – via l'instabilité financière (spéculation) – pour le développement économique, en termes quantitatif (surproduction) et qualitatif ("product mix" sous optimal).
Ce système de régulation devrait également neutraliser les effets indésirables des chocs technologiques et concurrentiels (mondialisation). Ces chocs ont pour effets bénéfiques de propulser le rapport qualité/prix des biens & services, mais ont généralement pour effets indésirables d'évincer les individus producteurs devenus obsolètes. L'AU permet à ces derniers de rester à flot et d'ainsi soutenir leur reconversion, sans complexités ni lourdeurs administratives grâce à l'inconditionnalité de l'AU.
Ce mécanisme de régulation automatique des marchés résulte de l'interaction entre les deux composantes de l'AU du modèle synthétique : distributive (notion de "symétrie monétaire") et redistributive (notion "d'écart de richesse optimal") :
l'AUD a pour effet de retirer aux banques leur fonction de création & allocation monétaire, qu'elles opèrent de façon sous-optimale (i) en exacerbant l'instabilité financière (cf. /creation-monetaire#chantage-risque-systemique ), et (ii) en accentuant l'écart de richesse moyen, par l'appropriation des biens fonciers mis en gage par des ménages pour obtenir un prêt, mais tombés en défaut de remboursement. En outre, la symétrisation monétaire rend le système économique plus efficace en termes de démocratie et, partant de développement durable :
ce ne sont plus les banques mais les ménages qui décident à quoi la création monétaire va être consacrée (c-à-d pour quels types de biens de consommation et de production) ;
ce ne sont plus les individus qui se concentrent là où est le capital, mais celui-ci qui se répartit là où vivent et travaillent les humains, favorisant ainsi la production locale (tandis que le système monétaire actuel permet de développer des technologies et puis de créer la demande, par la publicité au sens large, c-à-d y compris les films et séries télévisées).
l'AUR a pour effet de limiter les écarts de richesse, de façon objective, selon le principe d'écart de richesse optimal (ERO), qui postule que le niveau d'écart des richesses est tolérable tant qu'il permet le financement de l'AU du modèle synthétique (cf. /production#ecart-richesse-optimal ).
La réforme monétaire qui fonde l'AU distributive, et la réforme fiscale qui fonde l'AU redistributive ont pour effet d'abaisser le niveau moyen des écarts de revenus d'au moins 20% par rapport à son niveau actuel (cf. /financement-synthese#modele-synth).
Politique et production
Nos travaux sur le partage du pouvoir financier par l'AU sont menés parallèlement à nos travaux sur le partage du pouvoir politique par la démocratie directe. La nécessité d'un contrôle démocratique des moyens de production des biens et services essentiels illustre l'intrication entre pouvoirs politique et financier.
Ainsi par exemple, nous recommandons la création d'une banque publique (gérée sous statut de coopérative publique), où chaque citoyen dispose d'un compte bancaire sur lequel l'État lui verse son AU (mensuellement ou annuellement ?). C'est donc par cette banque publique que l'intégralité de la création monétaire et une partie de la redistribution fiscale sont opérées via l'AU.
C'est la logique d'économie mixte intégrale, par laquelle l'État (i) soutient les personnes physiques plutôt que les personnes morales privées, et (ii) fournit une offre publique de biens et services, via des entreprises (100 %) publiques, plutôt que via des partenariats public-privé (PPP) ou des délégations de service public (DSP) (cf. democratiedirecte.net/entreprise-publique).
Implémentation progressive
Bien que nos travaux apportent de nombreux éléments suggérant la souhaitabilité et la faisabilité de l'AU (de notre modèle synthétique), ceux-ci ne sont que théoriques. D'autre part, les expérimentations de l'AU ne peuvent être que partielles, locales et temporaires, de sorte que leurs résultats, malgré qu'ils sont généralement positifs, ne lèvent pas toutes les incertitudes (cf. /faisabilite#experimentations). Cependant, l'ensemble des faits évoqués dans ce résumé suggère qu'il fait peu de doutes que les systèmes de sécurité sociale peuvent évoluer vers l'AU du modèle synthétique. Pour ce faire, nos travaux proposent un plan d'implémentation prudemment progressif, constitué de quatre phases de trois ans chacune, soit une douzaine d'années au total (cf. /implementation).
Structure du sommaire
Les chapitre concernant l'AU sont les chapitres IV à XII. Il sont précédés de deux chapitres d'introduction, concernant les principes élémentaires :
- de comptabilité nationale, dont la compréhension permet d'appréhender efficacement la problématique de sécurité sociale ;
- de la sécurité sociale, ainsi que son analyse statistique, sur base de la France, la Belgique et l'ensemble des pays de l'OCDE.
Enfin la présente publication se termine par quatre dossiers approfondissant les notions, fondamentales pour l'AU du modèle synthétique :
- XIII. Production
- XIV. Travail
- XV. Monnaie
- XVI. Dette publique



