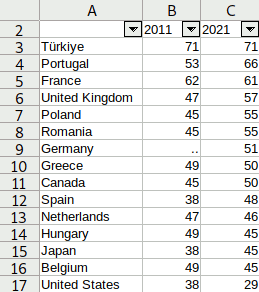XIII.2. Salaire minimum
Introduction

NB : "Salaire minimum légal" est un terme générique utilisé par nous. Les dénominations effectives varient selon le pays considéré.
Dans les pays les plus évolués les droits des travailleurs sont protégés (et développés) par des règles (lois ou accords) concernant les conditions de travail : salaire minimum légal (SML), temps de travail maximum légal (TML), normes sanitaires et de sécurité, etc.
On distingue deux "couches" réglementaires :
- un socle de base déterminé par la loi, et qui selon les pays varie en surface et épaisseur ;
- d'éventuelles conventions conclues entre syndicats et employeurs – au niveau national/sectoriel/d'entreprises et généralement pour une durée déterminée – fixant des conditions étendant les droits de base des travailleurs.
Dans l'UE six pays n'ont pas de SML : Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède - source). En Allemagne le SML n'existe que depuis 2015. Il ne s'applique pas à toutes les catégories de travailleurs [source].
Le SML et le TML sont à la fois des instruments de :
- justice sociale visant à neutraliser l'exploitation des salariés par les propriétaires des moyens de production ;
- progrès social dans la mesure où ils forcent les propriétaires des moyens de production à partager une partie des gains de productivité induits par le progrès scientifique et technologique.
Niveau du SML : analyse spatiale et temporelle
2. Comparaison avec les aides au revenu
3. Comparaison avec le salaire médian
Comparaison internationale
Le tableau suivant montre la grande disparité entre les pays du Nord-Est et ceux du reste de l'UE en matière de salaire minimum légal.
SML brut en euros
Comparaison avec d'autres minima sociaux
Le tableau suivant compare le montant du SML avec les autres minima sociaux en matière de revenu pour un isolé. Il s'agit des montants pour la Belgique, pays que nous utilisons comme référentiel dans cette publication étant donné la performance de son système socio-fiscal mesurée par le rapport entre niveaux de redistribution (*) et de rationalité du système fiscal.
(*) En Belgique le droit à l'allocation de chômage minimale n'est pas limité dans le temps, ce qui fait de ce pays probablement le plus plus proche d'une allocation universelle.
Minima sociaux pour un isolé (Belgique - 2023 - montants nets par mois, arrondis)
| Salaire minimum légal | 2.000 euros |
|---|---|
| Pension | 1.750 euros |
| Allocation de chômage | 1.400 euros |
| Revenu minimum garanti | 1.250 euros |
Source : luttepauvrete.be (1 jan. 2023)
Dans la plupart des pays le RMG est un système différentiel : lorsque les revenus d'un individu sont inférieurs à un certain montant (généralement, le seuil de pauvreté, généralement défini à 60 % du revenu disponible médian ), l'État lui verse la différence ... pour autant que l'ayant droit en fasse la demande (ce qui n'est pas toujours le cas, et cela pour différentes raisons : ignorance, découragement devant les procédures pas toujours compréhensibles, honte, ... cf. /securite-sociale-actuelle#nonrecours-vs-fraude).
Comparaison avec le salaire médian
Le tableau suivant compare le ratio SML / salaire médian dans des pays de l'OCDE.
On notera entre 2011 et 2021 :
- l'introduction d'un SML en Allemagne (2015) ;
- fortes augmentations: Pologne, Roumanie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni ;
- forte baisse : USA.
Problématique du SML
Entre les dispositions légales et la réalité de terrain il existe une disparité parfois notable. Il convient ainsi de distinguer :
- salaire minimum légal SML, c-à-d tel que défini par la loi ;
- salaire minimum observé (SMo), c-à-d tel qu'il est mesuré dans les statistiques officielles;
- salaire minimum effectif (SMe), c-à-d tel qu'il est en réalité.
La hiérarchie SML > SMo > SMe peut s'expliquer comme suit :
SML > SMo dans la mesure où des salariés "acceptent volontairement" un salaire horaire < SML [exemple1, exemple2?] , ce qui est d'autant plus fréquent lorsque les sanctions légale contre l'employeur sont ineffectives voire inexistantes ;
SMo > SMe dans la mesure où le travail est clandestin et donc non déclaré.
C'est la problématique des parties volontairement contractantes. Il importe que personne ne soit contraint "d'accepter" un salaire inférieur au SML.
D'autre part, l'obligation de payer un SML ne pouvant pratiquement porter que sur le salaire horaire, l'efficacité du SML est limitée par la part (croissante ...) du travail à temps partiel.
Ces faits n'impliquent pas pourtant la non pertinence du SML, mais la nécessité de le compléter par une AU permettant de subvenir aux besoins élémentaires, ce qui renforcerait substantiellement le pouvoir de négociation des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi. Malheureusement les syndicats sont généralement opposés à l'AU (cf. /critique#syndicats).
Opposition patronale au SML
Plus leur marché est concurrentiel, plus les entreprises tentent de forcer leurs salariés à accepter des salaires toujours plus bas. On notera en particulier :
le travail à temps partiel : suite aux politiques libérales de "flexibilisation du travail" (sic) de plus en plus de citoyens doivent cumuler divers emplois à temps partiel – généralement précaires (courte durée, peu de responsabilités, faible salaire, ...) – afin de pouvoir obtenir un salaire mensuel global approchant le SML ;
les pseudo "autoentrepreneurs" qui ne sont souvent que d'ex-salariés contraints par leur employeur de passer sous statut d'indépendant, c-à-d de devenir sous-traitant (PS : on pourrait y voir une évolution positive augmentant les capacités d'adaptation des "employeurs" comme des "employés", mais dans la majorité des cas il s'agit d'une précarisation des conditions de travail des seconds au bénéfice des premiers).
Le développement de la concurrence internationale (que l'on peut mesurer par la croissance de la part des exportations ou des importations dans le PIB de chaque pays), attise l'opposition des employeurs privés à l'encontre des réglementations du travail, dans la mesure où celles-ci augmentent le coût du travail.
La réaction des employeurs peut être :
- des investissements de rationalisation (remplacer du travail par du capital, c-à-d des salariés par des machines) ;
- la délocalisation de leur activité dans des pays où cette réglementation est plus laxiste ("dumping social").
Le Fordisme est bien loin. La mondialisation du commerce et de la concurrence n'a pas que des effets positifs car elle entraîne également le dumping social (ainsi que fiscal et environnemental).
Salaires et productivité
Le graphique suivant illustre le fait que la croissance annuelle moyenne du salaire horaire moyen sur la période 2000-2019 fut d'environ 2 %, alors que celle de la productivité horaire fut d'environ 1 %. On ne peut donc parler "d'exploitation du travail".
Productivité et durée du travail (France)
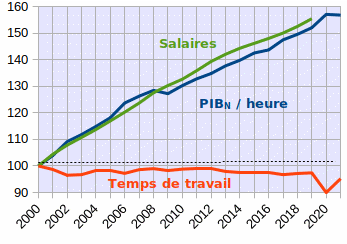
Source : OCDE. Tableur productivite-et-duree-du-travail.ods.
Tous les articles du dossier Travail :
- Temps de travail
- Salaire minimum légal
- Chômage et précarisation du travail
- Retraite
- Travail et valeur
- Travail libre
- Thermodynamique